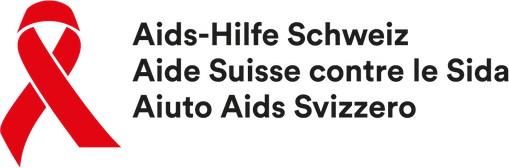«Ma vision de la masculinité avait volé en éclats»
Philipp Spiegel a été testé positif au VIH en 2013. Le diagnostic est tombé sans crier gare et a changé sa philosophie de vie tout comme sa perception de la masculinité et de la sexualité. Il raconte ici en toute franchise et sans fausse pudeur comment le diagnostic l’a déstabilisé dans sa condition d’homme et comment il a développé une nouvelle conscience de soi.

Philipp Spiegel
Dans ma vie de photographe, je m’appelle Christoph Philipp Klet-termayer. Dans ma vie d’auteur et d’artiste, je m’appelle Philipp Spiegel – un pseudonyme que j’utilise uniquement pour mes travaux en relation avec le VIH et qui me permet de prendre de la distance.
Octobre 2019 | Philipp Spiegel
Dans les premiers mois qui ont suivi le diagnostic, le VIH a dominé tous les aspects de ma vie. Il me pesait non seulement d’un point de vue médical, mais aussi psychologique, ce dont je n’ai pris conscience que bien plus tard. Je me mettais à douter de tout, surtout de moi-même. Je remettais en question le moindre de mes actes, la moindre de mes pensées ou opinions. J’avais attrapé le VIH – comment pouvais-je encore me faire confiance ? Hormis ces doutes, une autre question me taraudait: celle de ma masculinité perdue – et de ce qu’elle signifiait pour moi
La masculinité comme concept
J’étais affaibli, abattu, dépendant de l’Etat et de médicaments. Je n’étais pas en mesure de survivre sans l’aide d’autrui. A cela s’ajoutait la crainte du sexe – le sentiment d’être toxique et d’être perçu comme sexuellement dangereux. Ma confiance en moi était brisé en mille miettes, un sentiment d’impuissance m’envahissait tout entier. Ma vision de la masculinité avait volé en éclats. C’est vrai, mon ancienne définition avait collé à un cliché bien connu : l’artiste qui fume et qui boit, qui voyage à travers le monde à la recherche d’aventure et de femmes. Trop arrogant et trop cool pour le mainstream.Et tandis que j’aimais ce rôle, je haïssais passionnément les autres clichés masculins. Le fitness, le football, les voitures et les motos étaient pour moi des occupations ridicules. J’avais forgé ma vision de la masculinité en puisant dans la littérature, non dans des magazines masculins. Je cherchais ma testostérone dans des citations de Kundera ou d’Henry Miller – pas dans des articles puérils du genre «Comment avoir les muscles dont tu as toujours rêvé». Je constatais sans cesse que c’étaient précisément les hommes avec les plus gros muscles et le plus de tatouages, les barbes de hipster et les chignons les plus décoiffants qui fuyaient les véritables aventures, qui se contentaient de poser devant l’objectif, avides de likes. Je me moquais de ces personnages sur Instagram qui mettaient en scène leur masculinité à grand renfort de clichés. Tandis qu’ils faisaient des selfies de yoga à Bali, je buvais de l’eau-de-vie avec des rebelles maoïstes dans des bars illégaux à Katmandou. Je pouvais du moins opposer mes propres clichés masculins à leur superficialité