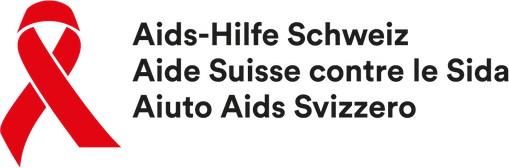Entretien avec Philipp Spiegel
«Ne pas parler que du VIH, mais aussi de sexualité et de constellations familiales progressistes»

Philipp Spiegel
Dans ma vie de photographe, je m’appelle Christoph Philipp Klet-termayer. Dans ma vie d’auteur et d’artiste, je m’appelle Philipp Spiegel – un pseudonyme que j’utilise uniquement pour mes travaux en relation avec le VIH et qui me permet de prendre de la distance.
novembre 2019
Vous adoptez une approche offensive face à votre séropositivité et vous en parlez ouvertement. Cela n’a pas toujours été le cas. Quelle importance accordez-vous à une campagne qui explique qu’une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH, y compris lors de rapports sexuels?
Je trouve ça extrêmement important. Avant d’être diagnostiqué séropositif, je n’en avais aucune idée et, très franchement, je ne sais pas comment j’aurais réagi face à une partenaire séropositive. Bien sûr, il faut faire attention à ne pas minimiser le VIH – ce qui ne simplifie pas les choses. J’ai envie de dire que ce qui compte, c’est de ne pas avoir peur du virus, mais de le respecter. Pour réussir ce grand écart, il faut aussi des campagnes nuancées comme celle de l’Aide Suisse contre le Sida.
«Il faut avoir une meilleure connaissance de la sexualité et combattre les peurs pour avoir une vie libre, où le plaisir a sa place.»
Vous vivez en Espagne et en Autriche et, en tant que photographe, vous voyagez beaucoup. Les gens en Europe savent-ils qu’ils ne doivent plus avoir peur des personnes séropositives sous traitement?
Hélas non. Je suis aussi frappé par la différence assez nette entre Barcelone et Vienne. Dans une Vienne plus conservatrice, il y a moins de sensibilisation et donc davantage de peur. L’attitude face à la sexualité étant plus ouverte à Barcelone, il y a moins de craintes à évoquer des aspects négatifs qui lui sont liés. De plus, Barcelone a une très grande communauté gay, ce qui fait que davantage de personnes sont concernées par la question. De manière générale, la situation rappelle encore le début des années nonante. Mais je crois que cela change petit à petit.
En quoi les politiciens peuvent-ils contribuer à faire en sorte que les personnes séropositives ne soient plus discriminées et stigmatisées?
Les politiciens doivent être sensibilisés et transmettre le message. Ils ne devraient pas parler que du VIH, mais aussi de sexualité et de constellations familiales progressistes. Les campagnes sont bien sûr tout aussi importantes et bien trop rares. En Autriche, il y a eu ce cas ahurissant d’une ancienne ministre de la santé qui a raconté plein de choses totalement fausses à l’occasion d’un événement caritatif dédié au VIH. C’est inadmissible, cela peut anéantir beaucoup de travail en peu de temps.
Que signifie pour vous la Journée mondiale de lutte contre le sida?
Le 1er décembre est l’un des rares jours où il est question du VIH dans les médias. Malheureusement, on présente la plupart du temps les statistiques dans des articles qui se ressemblent d’année en année et on raconte les choses «usuelles». A mon avis, on manque d’approches innovantes, originales. Depuis mon premier entretien voilà quatre ans, les questions que l’on m’a posées, du moins en Autriche, n’ont pour ainsi dire pas changé. Je trouve ça assez déprimant. Cette année, je fais une exposition près de Cologne pour la Journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre et j’accorde quelques entretiens dans les semaines qui précèdent. Je suis curieux de voir si les questions commencent enfin à changer.
A propos de la campagne, quel est votre sujet préféré et pourquoi?
Les deux sujets que je préfère sont «Contre la peur» et «Pour plus de compréhension» car c’est bien de ces deux choses dont il s’agit, et pas seulement concernant le VIH. Il faut avoir une meilleure connaissance de la sexualité et combattre les peurs pour avoir une vie libre, où le plaisir a sa place. Une journée que l’on accueille avec angoisse est une journée de perdue