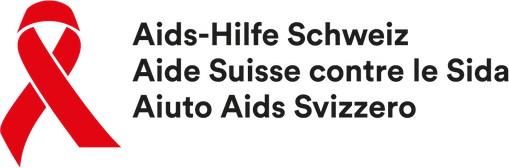Dix ans de médecine du VIH: bilan et perspectives
Au cours de la dernière décennie, aucun domaine médical n’a fait l’objet de recherches aussi intenses que celui de l’infection par le VIH. Les résultats ont été nombreux et les questions les plus urgentes semblent avoir obtenu une réponse. Mais de nouveaux défis surgissent. L’article qui suit retrace les principales percées des dix dernières années en médecine du VIH et montre les problèmes qu’il faudra résoudre à l’avenir.

Dominique Laurent Braun
Dominique Laurent Braun est médecin-chef à la Clinique des maladies infectieuses et d’hygiène hospitalière de l’Hôpital universitaire de Zurich ainsi que privat-docent en infectiologie à l’Université de Zurich. Il traite des personnes vivant avec le VIH depuis plus de dix ans.
Dominique Laurent Braun | Decembre 2020
La Commission fédérale pour les problèmes liés au sida a publié le 30 janvier 2008 un article au contenu provocateur: les personnes séropositives sous traitement efficace ne peuvent plus transmettre le virus par voie sexuelle.
La Déclaration suisse
Ce message connu sous le nom de Déclaration suisse a suscité de vives critiques à l’époque, ses détracteurs formulant notamment le reproche que les données à disposition n’étaient pas suffisantes pour une telle affirmation. Douze ans après, la Déclaration suisse est réputée prouvée. Les deux études PARTNER portant sur des centaines de couples hétérosexuels et homosexuels sérodiscordants ont en effet établi à quelle fréquence se transmet le VIH en cas de rapport non protégé si le partenaire séropositif est sous traitement et que sa charge virale est d’au maximum 200 copies par millilitre de sang. Résultat: avec plus de 130 000 rapports sexuels, pas une seule transmission du virus n’a été observée au sein des couples. Depuis, le message U = U («undetectable = untransmittable») a changé durablement la vie de millions de personnes séropositives, prévenant des infections et permettant aux personnes concernées de se sentir libérées et de vivre leur sexualité comme elles l’entendent.
Un moins pour un mieux
C’est en 2007 qu’il est apparu: un comprimé réunissant trois molécules qui représentait le premier traitement en une prise par jour, commercialisé sous le nom Atripla. Depuis, d’autres médicaments combinés ont vu le jour et simplifié le traitement d’innombrables patients. Comme l’attestent des études, l’observance thérapeutique est meilleure grâce à la prise unique quotidienne et au nombre réduit de comprimés, et ce pour une efficacité identique. Depuis, il existe des comprimés en mono-prise qui ne contiennent que deux molécules au lieu de trois et qui, de ce fait, ont le potentiel de diminuer les effets secondaires à long terme et les coûts. En dépit de ces succès thérapeutiques, de nouveaux défis surgissent: les médicaments utilisés le plus fréquemment peuvent entraîner une importante prise de poids chez certaines personnes et donc un risque accru de maladies cardiovasculaires. On ne sait pas encore comment survient cette prise de poids et si elle est prévisible, et la question occupe des chercheurs du monde entier.
Malgré les énormes progrès réalisés en médecine du VIH, un problème semble ne pas pouvoir être guéri: celui de la stigmatisation liée au VIH.
Le patient de Berlin
Guérir du sida, on y aspire depuis la découverte du VIH en 1983. Ce qui, au début de la pandémie de VIH, semblait à portée de main reste l’un des plus grands défis, plus de trois décennies après. L’histoire de Timothy Brown, connu sous le nom de patient de Berlin, raconte comment on peut guérir du VIH. Brown a été infecté par le virus en 1995 et a suivi depuis lors un traitement hautement efficace. Lorsqu’une leucémie agressive lui a été diagnostiquée en 2006, on lui a transféré le système immunitaire sain d’un donneur séronégatif par le biais d’une greffe de cellules souches. Celles-ci contenaient une mutation génétique leur conférant une résistance naturelle au VIH, ce qui, chez Brown, a fait que le VIH a été éliminé de toutes les cellules de son organisme. Jusqu’à son décès en 2020, Brown était la seule preuve vivante qu’une personne peut guérir du VIH. Ce qui reste, c’est le constat qu’une guérison est possible, et donc l’espoir que d’autres patients suivront Timothy Brown.
De nouvelles technologies dans la lutte contre le VIH
Les progrès des dix dernières années se reflètent dans la multitude de nouvelles technologies étudiées pour le traitement de l’infection par le VIH. L’intention est claire: simplifier encore les traitements et mieux les adapter aux souhaits des patients. Les traitements à longue durée d’action sont déjà autorisés dans certains pays, une combinaison de deux médicaments étant injectée dans le muscle fessier toutes les quatre à huit semaines. Les études révèlent que la méthode est aussi efficace que la trithérapie et, si l’on en croit les participants à l’étude, la plupart préfèrent cette nouvelle forme d’administration aux comprimés à avaler. D’autres études en cours à l’échelle mondiale examinent la sécurité d’emploi et l’efficacité de substances libérées dans l’organisme du patient ou de la patiente par l’intermédiaire d’anneaux vaginaux, de micro-patchs ou d’anticorps neutralisants à large spectre administrés en perfusion courte. En outre, on voit poindre à l’horizon de nouveaux groupes de molécules susceptibles d’être utilisés en combinaison contre des souches de virus très résistantes et de permettre de traiter tous les patients – pour autant que l’accès à ces traitements soit garanti.
Traitées avec succès, mais toujours stigmatisées
Malgré les énormes progrès réalisés en médecine du VIH, un problème semble ne pas pouvoir être guéri: celui de la stigmatisation liée au VIH. En 2020, des personnes séropositives continuent d’être stigmatisées dans différents domaines – même en santé publique. Une enquête de la cohorte suisse VIH (SHCS) a établi en 2015 les raisons pour lesquelles des personnes ne se tournaient vers les services de santé publique qu’à un stade tardif de l’infection par le VIH: dans près de la moitié des cas, c’était par peur d’être stigmatisées par des connaissances ou des amis. La cohorte suisse VIH a lancé récemment un nouveau projet qui étudie la stigmatisation liée au VIH de façon systématique. Les résultats permettront de mettre au point des interventions visant à abolir la stigmatisation liée au VIH. Le message est clair: non à la stigmatisation, oui à la solidarité.
COVID- 19 et VIH
Si, au début de la pandémie de COVID-19, on a espéré disposer d’un traitement efficace contre le Sars-CoV-2 grâce au Kaletra, un médicament contre le VIH, cet espoir s’est vite évanoui avec les premiers résultats des études: comme beaucoup de médicaments testés ultérieurement contre le Sars-CoV-2, le Kaletra ne montre aucun effet positif sur l’évolution de l’infection COVID-19. La question de savoir si les personnes positives au VIH ont un risque accru de développer une forme sévère de COVID-19 n’est pas encore totalement tirée au clair. Des publications récentes semblent le suggérer. La lutte contre la pandémie de COVID-19 ressemble à celle contre le sida au début des années 1980: il reste encore beaucoup à investiguer et les essais de nouveaux traitements se terminent souvent sur une déception. Mais une chose est sûre: jamais l’humanité n’a acquis autant de connaissances sur une nouvelle maladie infectieuse en aussi peu de temps. Pour le VIH, il a fallu bien plus longtemps.