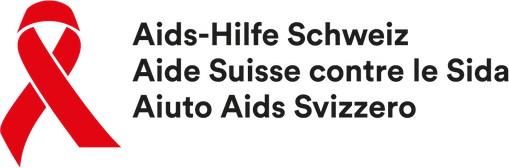«La déclaration suisse n’a pas été lue dans le marc de café, elle reposait sur des données scientifiques»
En 2008, la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFS) est montée au créneau en faveur des personnes séropositives sous traitement efficace. Sa fameuse déclaration suisse a fait des vagues et a été loin de faire l’unanimité.

Enos Bernasconi
Le Professeur Enos Bernasconi est le chef du service des maladies infectieuses à l’Hôpital régional de Lugano. Il enseigne à l’Université de Genève et il est membre de l’étude suisse de cohorte VIH. De 2001 à 2007, il a présidé la Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFS), rebaptisée Commission fédérale pour la santé sexuelle (CFSS).
Novembre 2018 | Brigitta Javurek
Professeur Bernasconi, la déclaration suisse a dix ans, mais Monsieur et Madame Tout-le-Monde ne savent toujours pas ce que veut dire «indétectable = intransmissible». Pourquoi?
C’est vrai. Plusieurs raisons font que cette déclaration n’est de loin pas encore connue de tout le monde. Le fait est que nous l’avons publiée en 2008 pour les personnes concernées, autrement dit les femmes et les hommes séropositifs. Ils ne devaient plus avoir peur de transmettre le virus et ils pouvaient, s’ils en avaient envie, vivre une sexualité plus détendue grâce au traitement efficace. En outre, les femmes séropositives qui le souhaitaient pouvaient réaliser leur désir d’enfant sans risquer d’infecter leur compagnon. Un autre message important avait trait à la situation juridique en Suisse qui était alors très préoccupante pour les personnes vivant avec le VIH, fortement pénalisées. Les femmes et les hommes séropositifs étaient considérés comme des facteurs de risque de propagation d’une infection sexuellement transmissible. La déclaration a changé la donne. En effet, une personne dont la charge virale est indétectable ne peut plus transmettre le virus et ne peut donc plus être condamnée pour propagation d’une IST. En 2009 déjà, une année après la publication du fameux article, on a fait appel au Professeur Bernard Hirschel, membre de la CFS, dans le cadre d’une procédure judiciaire suisse et, suite à ses déclarations, le prévenu séropositif n’a pas été condamné. Cela n’aurait pas été possible sans la déclaration suisse.
Quelle était la tâche de la commission?
La CFS était composée de femmes et d’hommes issus de différents horizons. Il y avait là des médecins, psychologues, sociologues et juristes, des représentants de l’Aide Suisse contre le Sida et aussi des personnes séropositives. Nous formions une commission extraparlementaire qui agissait en toute indépendance et tenait les politiciens informés de la situation. Notre mission consistait à évaluer les efforts de prévention en matière de VIH et de sida, à les reconsidérer et, le cas échéant, à les repositionner en tenant compte de tous les aspects cliniques, sociaux, techniques et judiciaires. Les politiciens nous posaient régulièrement des questions très concrètes. Par exemple, on avait entendu dire que des personnes séropositives sous traitement efficace ne transmettaient plus le virus – il y avait déjà des spécialistes du VIH qui donnaient la bonne nouvelle à leurs patients. Nous disposions par ailleurs de données en provenance de la fameuse étude de cohorte dans la région de Rakai en Ouganda. En outre, plusieurs études révélaient qu’on avait observé une réduction massive du risque de transmission du VIH chez des couples sérodifférents lorsque la personne séropositive était sous traitement efficace, et ce indépendamment de l’usage systématique des préservatifs.
Comment se fait-il que ce soit précisément la petite Suisse qui ait rendu cette déclaration publique?
La petite Suisse n’était pas si petite que ça au vu du nombre de personnes séropositives, elle affichait même une prévalence élevée à l’échelon européen. C’était un «héritage» de la scène de la drogue et de la scène active des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. A l’époque, le VIH était un gros problème et un sujet très débattu en Suisse. De plus, nous avions deux éminents chercheurs et formateurs d’opinion, à savoir les professeurs Ruedi Lüthy et Bernard Hirschel, qui disposaient – et disposent d’ailleurs toujours – d’un excellent réseau également au plan international. Hirschel était un esprit créatif qui ne cessait de surprendre avec ses bonnes idées. Quant au professeur Pietro Vernazza, chercheur et président de la commission, il avait prouvé que la charge virale était très basse, voire indétectable, dans le sperme ou les sécrétions vaginales d’une personne séropositive sous traitement. Par conséquent, nous disposions en Suisse de données probantes issues d’études de cohorte publiées et d’études biologiques. On ne lisait pas dans le marc de café, on s’appuyait sur des données avérées. Il ne s’agissait pas d’être les premiers à rendre ces données publiques. Nous avons pris la décision dans le cadre d’un groupe multidisciplinaire, encouragés par d’éminents chercheurs. Nous voulions couper court aux spéculations et aux interprétations en partie erronées et faire la lumière sur ce qui était vrai et ce qui ne l’était pas – par exemple qu’il suffirait de prendre des médicaments pendant quelques jours pour ne plus être infectieux. La déclaration était formulée de manière très prudente, comme nous le savons aujourd’hui. Mais à l’époque, elle a fait l’effet d’une bombe. Il y a eu quelques réactions violentes.
Comment la déclaration a-t-elle été accueillie?
Au début surtout, certains acteurs, dont l’Aide Suisse contre le Sida, se sont montrés plutôt sceptiques face à la déclaration. On nous a reproché d’anéantir vingt ans de prévention du sida. Ce n’était évidemment pas notre intention. Nous voulions montrer qu’il existe un autre moyen de prévention et que le préservatif n’est pas le seul à protéger du VIH de manière fiable. Et nous jugions important d’en parler, qui plus est officiellement, et non de façon spéculative. Aujourd’hui, nous savons que le traitement est plus efficace que le préservatif qui peut se déchirer à l’occasion ou ne pas être utilisé correctement.
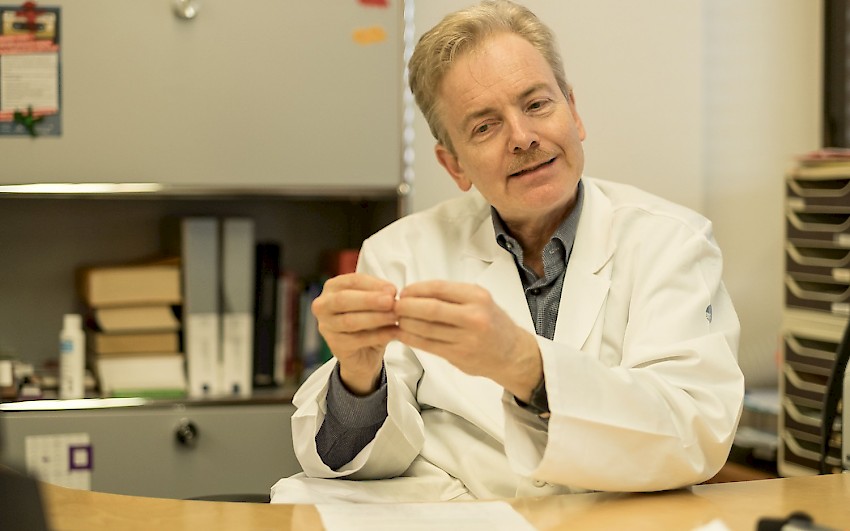
La CFS était-elle préparée à ces réactions?
Oui, nous y étions préparés. Et notre déclaration devait aussi inciter à de nouvelles études à plus large échelle. La collaboration internationale a contribué, là aussi, à consolider les chiffres et à confirmer que nous avions raison.
Et aujourd’hui?
Des couples sérodifférents, autrement dit dont l’un des membres est séropositif, m’ont été régulièrement envoyés notamment par des collègues italiens jusqu’il y a deux ou trois ans. Ces médecins connaissaient bien sûr la déclaration suisse et l’efficacité du traitement, mais il n’était pas opportun de prendre officiellement position à cet égard en Italie. C’est donc moi qui ai eu la mission d’informer ces couples, de les soulager de la peur d’une infection et de leur permettre une grossesse naturelle. Mais même en Suisse, dans le cadre de mon enseignement à l’université, il m’arrive de rencontrer de jeunes collègues qui ne connaissent pas la déclaration suisse. Le message de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) se résume aujourd’hui à la formule: «U = U: Undetectable = Untransmittable ». Nous ne pouvions pas l’exprimer sous cette forme en 2008, nous avions encore trop peu de données. Aujourd’hui, nous disposons de suffisamment d’études prospectives probantes, dont les études PARTNER 1 et PARTNER 2, et nous pouvons adhérer pleinement à «U = U». Il faut maintenant diffuser ce message par tous les canaux à disposition, dans.