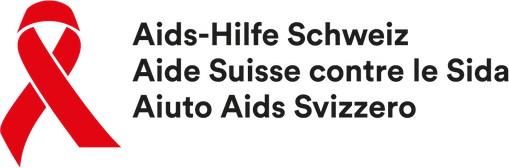«Le sida a pris la médecine au dépourvu»
En juin 1981 apparaissait le sida, qui a décimé, depuis, près de 30 millions de personnes dans le monde. L’historien Vincent Barras revient pour «Le Temps» sur cette maladie qui a bouleversé les mœurs et la façon de concevoir les épidémies.

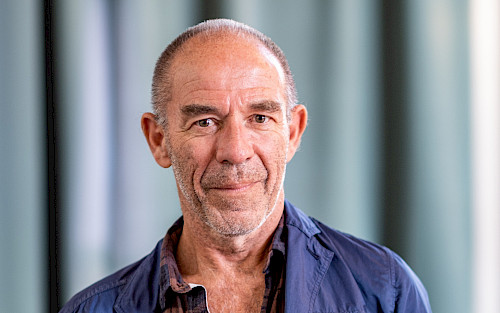
Vincent Barras
Vincent Barras, médecin et professeur à l'Institut d'histoire de la médecine à l'Université de Lausanne.
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIEN BURRI | Decembre 2021
Vous êtes un des premiers à avoir ausculté un malade du sida en Suisse, en 1981.
Je venais de recevoir mon diplôme de médecin-chirurgien, et j’ai été engagé à l’Institut de médecine légale, qui avait une unité de médecine pénitentiaire à l’Hôpital cantonal. A l’été 1981, j’ai reçu un patient qualifié de toxicomane, incarcéré préventivement à Champ-Dollon. Il est arrivé dans un état de santé très détérioré. J’ai remarqué des grappes d’adénopathies – c’est-à-dire de ganglions – un peu partout, dans les creux sus-claviculaires, le long du cou, dans les aines… Je n’avais jamais vu cela. J’ai signalé le cas à mon chef de clinique, nous ne comprenions pas… Quarante ans plus tard, j’ai encore la sensation de ces ganglions sous les doigts. Le début de mon parcours pro–fessionnel a coïncidé avec l’arrivée du sida.
Comment se prononcent les spécialistes, à l’époque, sur le patient dont vous êtes chargé?
Nous faisons appel au professeur d’infectiologie de l’hôpital, Francis Waldvogel, mais lui ne sait pas non plus de quoi il s’agit. Il est toutefois au courant de bruits qui commencent à circuler dans la communauté scientifique, en provenance des Etats-Unis, au sujet de cas présentant des infections graves, des cancers inhabituels, des adénopathies en masse. Visionnaire, il nous conseille de prélever et de congeler un ganglion. Il était trop tôt pour comprendre ce qui se passait, mais on pouvait espérer découvrir quelque chose dans ce ganglion plus tard… J’ignore ce qui est advenu, ensuite, de ce patient.
«On a mis deux ans et demi pour avoir la preuve de l’existence du virus responsable. Le mode de transmission nous dépassait, lui aussi»
La maladie que vous observez alors n’a pas encore de nom?
Le 5 juin 1981, un journal médical américain, le Morbidity and Mortality Weekly Report, fait état de cinq cas suspects de pneumonie dans la communauté gay de Los Angeles. On considère aujourd’hui que c’est la première publication à témoigner de l’apparition du VIH/sida. C’est un court article, presque rien. C’est pourtant le premier frémissement, la première petite bulle qui monte à la surface, avant le bouillonnement que sera l’épidémie. La maladie sera baptisée de divers noms, et plusieurs virus seront incriminés: HTLV-3, LAV… Vers 1983-1984, on s’accorde sur l’acronyme VIH (ou HIV), et on prend l’habitude de l’accoler au syndrome d’immunodéficience acquise: VIH/sida. C’est le fruit d’un compromis entre les spécialistes américains et français, alors à la pointe de la recherche sur cette maladie.
Vous avez également procédé à l’autopsie d’un malade décédé du sida?
J’ai travaillé ensuite en pathologie, dans ce qui s’appelait alors l’Institut pathologique de l’Hôpital universitaire de Genève. On a commencé à autopsier des malades du VIH/sida, décédés de pneumonies ou de ce qui ressemblait à des cancers généralisés (le sarcome de Kaposi). J’ai effectué un prélèvement dans les poumons d’un malade, dont on ne connaissait pas bien les causes de la mort, et observé les petites grappes de spores d’un agent infectieux peu courant, le Pneumocystis carinii (qui a changé de nom depuis). On retrouvait ce microorganisme dans les poumons des malades immunodéprimés.
Pourquoi a-t-on mis si longtemps à identifier cette maladie?
Il fallait comprendre que le VIH/sida n’est pas une maladie en tant que telle, mais qu’elle crée un état d’immunodéficience ouvrant la porte à d’autres maladies. La médecine a dû repenser sa façon de concevoir ce qu’était une épidémie. On a mis deux ans et demi pour avoir la preuve de l’existence du virus responsable. Le mode de transmission nous dépassait, lui aussi. C’est à la fin des années 1980 qu’on l’a compris. Enfin, ce n’est qu’au milieu des années 1990, avec les mono-, bi-, puis trithérapies, que le VIH/sida s’est pour ainsi dire transformé en maladie chronique.
Vous aviez peur de traiter les malades?
On avait une peur terrible de cette maladie qu’on ne comprenait pas. Le personnel soignant était très stressé. Même pour pratiquer les autopsies, on nous demandait de mettre quatre couches de gants superposés, des masques et des scaphandres. Mais nous n’étions pas bien équipés. La médecine, souvent oublieuse de son passé, était prise au dépourvu. Elle croyait, non sans arrogance, en avoir terminé avec les maladies infectieuses, au point qu’une discipline comme l’infectiologie semblait presque tomber en désuétude.
Le sida existait déjà avant sadécouverte officielle?
Les historiens, virologues et épidémiologues, tel Jacques Pépin, ont pu démontrer que le sida existait depuis des décennies. On a remonté jusqu’aux années 1920 pour trouver sa trace dans l’Afrique coloniale. Le virus humain, le VIH, est né de la mutation d’un virus animal, passé de l’animal à l’homme par contamination sanguine. Le sida résulte, pense-t-on aujourd’hui, d’un commerce entre l’homme et le chimpanzé, dans le contexte d’une rupture d’équilibre écologique, de changements démographiques, sociaux et politiques majeurs à la fin de l’ère coloniale en Afrique subsaharienne, avec tous les bouleversements que cela a impliqués. Cela rappelle fortement, par certains aspects, ce que nous pouvons savoir de l’émergence de la pandémie de COVID! Toutefois, le VIH est resté longtemps un virus à bas bruit, avant de se développer dans des foyers circonscrits, au gré de l’explosion démographique, dans divers grands centres urbains de l’Afrique équatoriale, puis de se propager rapidement sur le reste de la planète à la fin des années 1970. Une conjonction de micro-catastrophes locales a provoqué une catastrophe globale. C’est une illustration de l’«effet papillon».
A l’époque, on a cherché des causes morales à l’origine de cette maladie… En Suisse, le skieur Pirmin Zurbriggen estimait qu’il s’agissait d’une «punition divine» sur les homosexuels.
Comme dans le cas de la pandémie actuelle, on se dit que certains auraient mieux fait de garder le silence… Pour le VIH/sida, on a mis longtemps à comprendre que tout le monde était concerné. Au début, les communautés en cause, les premières victimes «visibles», étaient très caractérisées: certains homosexuels et certains toxicomanes. Il était facile d’en faire des victimes expiatoires, et les a priori moraux, auxquels participaient les scientifiques, ont joué à plein. La stigmatisation d’un groupe particulier est un classique dans l’histoire des épidémies. On rendait les Juifs responsables de la peste au Moyen Age. Au XIXe siècle, les pèlerins musulmans venus d’Asie étaient désignés comme responsables de la transmission du choléra…
«La stigmatisation d’un groupe particulier est un classique dans l’histoire des épidémies. On rendait les Juifs responsables de la peste au Moyen Age.»
Comment cette épidémie a-t-elle fait évoluer les mentalités?
Le VIH/sida a tué plus de 30 millions de personnes. Il a fait beaucoup de mal. Sans être cynique, on peut aussi essayer de voir ce qu’il a apporté. Il a par exemple permis aux communautés gays de s’affirmer, de sortir du placard, de se manifester avec solidarité, d’agir, de pouvoir influer sur les politiques de santé. Le VIH/sida a été l’occasion de montrer la puissance des groupements de patients, et la nécessité pour le système de la médecine d’en tenir compte. Pensons à Act Up, qui revendiquait l’accès aux thérapies. Cela a contribué à déboulonner le statut très patriarcal et autoritaire d’une certaine médecine.
Le sida est loin d’être vaincu aujourd’hui, mais on dirait qu’il ne fait plus peur.
Il est banalisé, alors qu’on compte toujours près de 700 000 morts par an sur la planète, pour des motifs qui n’ont rien à voir avec la virulence du virus, mais avec l’incurie humaine, les inégalités sociales et économiques, les structures de pouvoir… Certains dirigeants continuent de dire que le sida est une punition divine. Comme les autres virus, le VIH continue de muter, ce qui empêche pour l’heure de disposer d’un vaccin efficace. Le sida s’est invisibilisé, ses morts sont redevenus silencieux, mais il existe toujours.
> Cet article a été mis gracieusement à la disposition de Swiss Aids News. Il est paru pour la première fois le 8 juillet dans Le Tempes (www.letemps.ch)